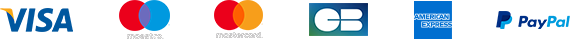4. Chapitre 2 : Les formalités du mandat
Le mandat immobilier se doit de remplir certaines obligations édictées par la loi Hoguet, mais avant tout, il répond à la législation qui entoure tout contrat apparaissant dans le Code civil.
L’article 1101 du Code civil
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1128 du Code civil
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
- 1° Le consentement des parties ;
- 2° Leur capacité de contracter ;
- 3° Un contenu licite et certain. »
La notion de consentement
Nous allons aborder la notion de consentement sous l’angle du droit français, selon l’article 1102 du Code civil qui décrit le fait que :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. »
En somme, il s’agit du libre arbitre de chaque partie qui résulte la conclusion d’un contrat, et donc, d’un accord. Bien que le consentement ne bénéficie pas d’une définition propre dans le Code civil, ce dernier texte précise tous les cas qui s’opposent à cette notion de consentement (articles 1130 à 1144 du Code civil), appelés « vices de consentement. Cette notion est inscrite à l’article 1130 du Code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
La définition de l’erreur
En droit, l’erreur se définit par une information fausse sur l’un des éléments essentiels du contrat, causant la nullité de ce dernier. L’erreur se veut excusable, car non intentionnelle. Il doit donc correspondre à une erreur :
- Les qualités essentielles de la prestation (estimation d’un bien, authenticité d’une œuvre d’art, etc.)
- Les qualités du cocontractant si elle nuit à la légitimité du contrat (une erreur sur les compétences décrites pour une embauche, etc.)
La définition du dol
Le dol est un vice du consentement qui peut entraîner l’annulation d’un contrat (article 1137 du Code civil). Il est constitué par une intention de tromper l’autre partie soit en lui dissimulant une information, soit en lui faisant une fausse promesse.
Il existe deux types de dol :
- Le dol principal : Le dol principal est celui qui est commis avant la conclusion du contrat et qui a pour but de tromper l’autre partie.
- Le dol incident : Le dol incident est celui qui est commis après la conclusion du contrat, mais qui modifie substantiellement l’équilibre du contrat.
Le dol peut être invoqué par la victime pour annuler le contrat. L’annulation du contrat est une sanction qui a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La définition de la violence
La violence est un vice du consentement qui peut entraîner l’annulation d’un contrat. Elle est constituée par une contrainte physique ou morale qui fait pression sur une personne pour qu’elle signe un contrat (abus d’un état de dépendance, menace, pression, etc.).
La violence peut être invoquée par la victime pour annuler le contrat. L’annulation du contrat est une sanction qui a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
La notion de bonne foi
Le principe de bonne foi est un principe général du droit qui s’applique à tous les contrats, quels que soient leur nature et leur objet. Il impose aux parties à un contrat de se conduire de manière loyale et honnête. Il implique qu’elles doivent agir dans l’intérêt de l’autre partie et éviter de lui nuire. Il est notamment mentionné à l’article 1134 du Code civil, qui dispose que « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ».
Le Code civil a évolué en 2016 pour étendre le principe de bonne foi à la phase de négociation des contrats, comme l’énonce l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
La notion de capacité
Le Code civil prescrit qu’un contrat ne peut être contracté par une personne physique qui est frappée d’incapacité (articles 1145 et 1146). Ainsi, cela désigne :
- Les mineurs non émancipés
- Les majeurs protégés par une curatelle, une tutelle ou une sauvegarde en justice
Le mineur non émancipé
Article 388 du Code civil
« Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. »
Ainsi, cette définition les interdit de contracter d’eux-mêmes des actes administratifs, hormis par l’intermédiaire d’un représentant légal.
Cependant, à partir de 16 ans, il est possible pour un mineur de s’émanciper, et ce, uniquement par jugement prononcé par un Juge des tutelles, suite à une demande émise par un parent ou un conseil de famille. Dans ce cas bien précis, l’émancipation donne droit au mineur d’exercer ses droits en tant que majeur et de mettre une fin définitive à l’autorité parentale.
Le majeur protégé
Un majeur protégé est une personne adulte qui, en raison de son état de santé physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts et de prendre des décisions pour elle-même. Cette incapacité peut résulter d’une maladie, d’un handicap, d’une altération des facultés mentales ou de toute autre cause.
Lorsqu’un majeur est considéré comme protégé, c’est-à-dire qu’il est dans l’incapacité d’assumer pleinement ses droits et devoirs juridiques, des mesures de protection légale peuvent être mises en place pour garantir sa protection et la gestion de ses affaires. Ces mesures visent à protéger les intérêts du majeur vulnérable et à assurer sa sécurité et son bien-être.
Dans ce cas, les formes de protection peuvent être la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde en justice.
La tutelle
La tutelle est une décision de justice qui vise à protéger un adulte et éventuellement son patrimoine lorsqu’il est dans l’incapacité de prendre soin de ses intérêts.
Dans le cadre de la tutelle, un tuteur est désigné pour agir au nom de la personne concernée dans les aspects de la vie quotidienne.
Le juge peut définir les domaines dans lesquels la personne peut prendre des décisions de manière autonome, ainsi que ceux dans lesquels elle a besoin de l’assistance du tuteur, en fonction de la situation spécifique. Ces décisions peuvent être prises au cas par cas et peuvent être modifiées par le juge en fonction de l’évolution de la situation.
La curatelle
La curatelle est une décision de justice visant à protéger un adulte et son patrimoine. Elle permet à la personne d’être conseillée et/ou accompagnée dans les actes importants qui engagent son engagement financier ou patrimonial, tels que les emprunts ou la vente de biens immobiliers. Toutefois, la personne reste autonome pour effectuer des actes simples de la vie quotidienne, tels que les achats courants ou le choix de se marier.
Il existe différents degrés de curatelle, déterminés en fonction des besoins et des capacités de la personne concernée.
La personne sous curatelle est assistée d’un ou plusieurs curateurs désignés par le juge. La curatelle a une durée limitée et permet une intervention plus légère que la tutelle, tout en encadrant davantage les actions du majeur protégé.
La sauvegarde en justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire qui permet à un adulte d’être représenté dans certains actes de la vie quotidienne. Elle vise à éviter la mise en place de mesures plus contraignantes telles que la tutelle ou la curatelle.
Il existe deux types de sauvegarde de justice : la sauvegarde médicale et la sauvegarde judiciaire.
La sauvegarde de justice peut s’appliquer aux personnes suivantes :
- Les adultes confrontés à des difficultés physiques ou psychologiques liées à une maladie.
- Les adultes atteints d’une infirmité ou d’une diminution de leurs capacités liée à l’âge.
- Les adultes présentant une altération de leurs facultés physiques et/ou mentales les empêchant d’exprimer leur volonté.
La sauvegarde médicale est mise en place suite à une déclaration faite par un médecin au procureur de la République. Cette déclaration peut provenir :
- soit du médecin traitant de la personne à protéger (avec l’avis conforme d’un psychiatre).
- soit du médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.
La sauvegarde de justice vise à protéger temporairement les intérêts de la personne concernée, en lui permettant d’être accompagnée et représentée dans les actes de la vie courante.
Les mentions obligatoires d’un mandat
Pour qu’un mandat soit valide, il doit comporter des informations essentielles et obligatoires :
- Le numéro et le lieu de délivrance inscrit sur la carte professionnelle du mandataire (dans le cas où l’autre partie du contrat est un collaborateur, il doit se munir d’une attestation rédigée par le titulaire de la carte professionnelle en guise d’autorisation).
- Le nom et l’adresse de l’entreprise, sa forme juridique, le montant du capital et l’activité exercée.
- Le nom et l’adresse du garant.
De plus, les articles 72 et 73 de la loi Hoguet précisent la forme et les conditions du mandat :
Article 72 de la loi Hoguet
« Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
“Transactions sur immeubles et fonds de commerce” ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73.
Lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du Code civil.
Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans. »
Article 73 de la loi Hoguet
« Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “Transactions sur immeubles et fonds de commerce “, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou d’autres honoraires à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d’actes et de séquestre.
Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l’occasion de cette opération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties.Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatés par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire. »